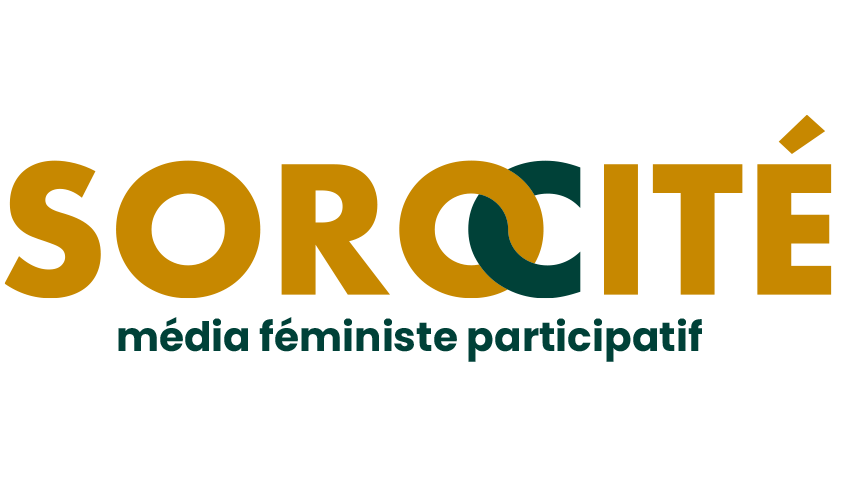Pink Story n’est pas facile à lire. Et ce n’est pas non plus le genre de bande dessinée que vous lirez en quelques heures au fond du lit. Pink Story, c’est une odyssée. Trois-cent vingt pages riches de dessins, de notes, d’anecdotes et d’infos. Interview de l’autrice Kate Charlesworth, icône de la BD outre-Manche.
Les trois-cent vingt pages dans lesquelles de Pink story, raconte l’itinéraire d’une jeune lesbienne qui découvre son orientation sexuelle dans le Londres des années 1970. Une histoire que l’autrice mêle avec une rigueur encyclopédique et beaucoup d’humour à l’histoire des mouvements LGBTQIA+.
Une manière pour elle de transmettre. “Toute l’idée de cet album est que les plus jeunes comprennent leur histoire, car tout le monde devrait connaître l’histoire des communautés auxquelles il appartient », explique-t-elle. Les manifestations contre la législation homophobe, les campagnes pour l’égalité des droits, l’avènement de la littérature queer… L’histoire des mouvements LGBTQIA+ n’est pas un long fleuve tranquille, elle est écrite par des personnes courageuses et peuplée de représailles et de retours de bâton (backlash). Kate Charlesworth raconte tout cela : la répression, la honte, l’humiliation, les avancées et les retours en arrière. Elle revient jusqu’en 1950 pour observer le chemin parcouru et donner à voir celui qui reste encore à faire.
Pourquoi avoir choisi de mêler votre histoire à celle du mouvement LGBTQIA+ ?
Kate Charlesworth – Quand j’ai commencé à imaginer illustrer l’histoire LGBTQIA+, je savais que j’allais devoir faire très attention à la structure. C’est un sujet tellement vaste ! Je voulais inclure un maximum de communautés, d’histoires et d’individus possibles, avec une attention particulière portée à l’expérience lesbienne. Les femmes sont déjà si souvent omises dans l’Histoire… Quant aux femmes lesbiennes, elles ont été plus ou moins invisibilisées. Alors je me suis dit qu’entrelacer mon histoire personnelle (de 1950 à la date de publication) serait une excellente façon d’ancrer le reste du récit. Après tout, j’étais là lors de la plupart des événements majeurs, j’ai travaillé dans la presse gay, où mes collègues dessinateur·trice·s queer et moi avons accidentellement documenté l’histoire LGBTQIA+, depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui.
En Angleterre, le lesbianisme n’a jamais été un délit. L’interdiction était sous-entendue. Quelle conséquence cela a eu selon vous pour les générations de lesbiennes ?
Le lesbianisme n’a jamais été criminalisé en Angleterre, en revanche il y a eu une tentative du Parlement de changer la loi en 1920 ; mais ça aurait signifié faire la promotion d’une “grossière indécence” entre femmes, et peut-être même encourager des femmes soi-disant respectables et passives (comme des épouses, des filles de législateurs) à s’intéresser de plus près au sujet ! Alors l’ordonnance a échoué et la cape d’invisibilité a sagement repris sa place. Lors des rares occasions où cette cape d’invisibilité se soulève, on y retrouve invariablement la honte, la culpabilisation et la condamnation. Les lesbiennes, malgré le manque de législation, ont toujours été vues comme une menace encore plus insidieuse par notre société patriarcale ; par exemple, on a systématiquement refusé la garde de leurs enfants aux mères lesbiennes, et ce, jusqu’à encore récemment.

Certaines femmes qui se savaient attirées par d’autres femmes ont trouvé des lieux où elles pouvaient rencontrer des personnes comme elles. La scène des bars et clubs était, je pense, principalement composée de classe ouvrière jusque dans les années 1970. Avec la seconde vague de féminisme, les lesbiennes, dont beaucoup avaient déjà été mariées et/ou avaient eu des enfants, ont commencé à remettre en question la structure hétéronormative de notre société. Soutenues par d’autres féministes, elles ont milité pour leur visibilité et pour l’égalité.
Vous parlez beaucoup de la culture camp*. Pourquoi est-elle si importante selon vous ? En quoi impacte-t-elle aussi les lesbiennes ?
Le camp, c’est une libération ; c’est subversif, drôle, grivois, créatif ; parfois flamboyant, parfois discret, mais toujours fun. C’est une antithèse des normes tristes de la société et une célébration de “l’autre”. Mais les lesbiennes étaient souvent exclues de cette fête justement. Ça m’énervait (et beaucoup de mes potes gouines aussi) que le camp soit vu exclusivement pour les hommes gays. Des femmes queer, drôles, spirituelles, subversives et célébrées – certaines même en sequins et paillettes – ça ne collait pas avec l’image que la presse et le public (et certains hommes gay) avaient des « gouines/féministes mal baisées » et « misandres en salopette ».
Donc, les lesbiennes n’étaient pas camp. Faux ! Beaucoup d’hommes gay n’avaient pas un soupçon de camp attitude en eux. Certaines d’entre nous en avaient ras le bol, alors quand le camp a rencontré la politique et le militantisme, dans l’art comme sur la scène des théâtres et cabarets, ça a grandi exponentiellement. Ça a prouvé que c’était un mix très puissant, puisque l’humour est une arme très puissante. Et on en avait à revendre.
*Pour en savoir plus sur la culture camp, n’hésitez pas à lire Notes on “Camp” de Susan Sontag.

Pink Story
Kate Charlesworth
Ed. Casterman
Août 2021
25€